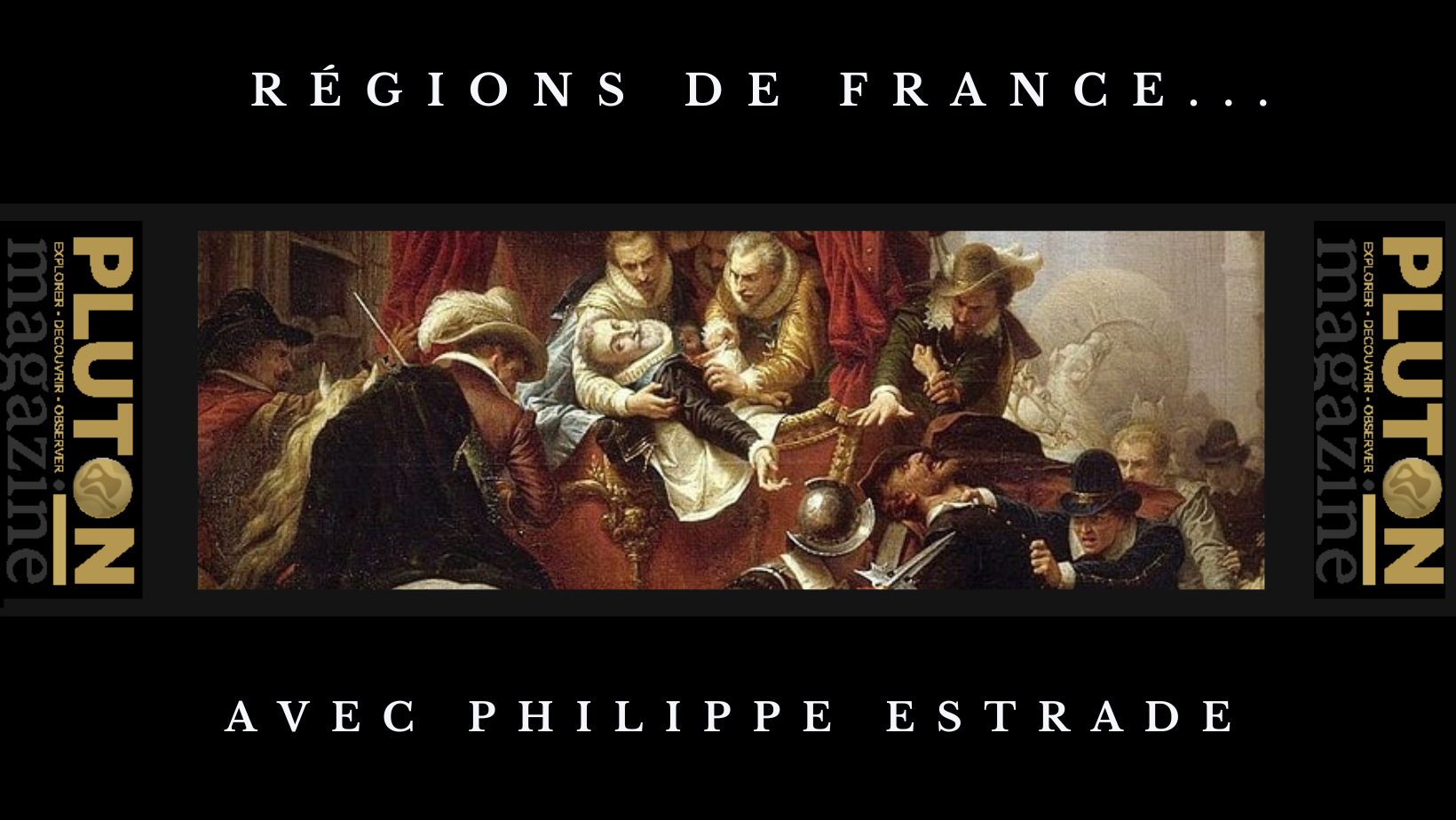Par Philippe Estrade
.
Jean-Louis de Nogaret de la Valette, duc d’Épernon, est un immense personnage de l’histoire de France qui a servi trois souverains, Henri III, Henri IV d’ailleurs mort dans ses bras et Louis XIII sans oublier les périodes de régence de Catherine de Médicis et Marie de Médicis. Cadet de Gascogne, Jean-Louis a participé activement aux guerres de religion puis, s’est attaché à servir ces trois rois avec ambition certes, mais toujours dans la fidélité. Doté d’une intelligence hors du commun, le verbe vif et le tempérament passionné, de Nogaret de la Valette se créa de puissantes inimitiés et jalousies. Il affichait avec fierté son empreinte du sud-ouest, n’en déplaise à ceux qui auraient souhaité qu’il abandonnât progressivement son accent gascon au profit d’une tonalité « plus française » issue de l’oïl désormais tout puissant.
L’ASCENSION DU CADET DE GASCOGNE
Né en 1554 à Cazaux-Savès dans le Gers actuel, il est le fils de Jean Nogaret de la Valette, seigneur du château de Caumont près d’Auch et de Jeanne de Saint-Lary de Bellegarde. Avec un père et un grand-père qui ont combattu lors des guerres d’Italie sous Louis XII et François 1er, il n’est pas surprenant que le jeune Jean-Louis ait embrassé la carrière militaire. Sous l’ancien régime, les cadets de Gascogne étaient souvent des gentilshommes pas suffisamment fortunés pour intégrer une prestigieuse et coûteuse académie militaire, mais ils obtenaient cependant la possibilité de réaliser une carrière d’officier au sein de la troupe et sur les champs de bataille.
Au siège de La Rochelle
Fidèle à son engagement catholique, Jean-Louis de Nogaret de la Valette, alors âgé de 19 ans, participa au siège de La Rochelle contre les Protestants en 1573 sous Charles IX, bien avant celui de Richelieu au siècle suivant. C’est d’ailleurs lors de ce siège de 1573 qu’il rencontra le duc d’Anjou, futur roi Henri III dont il devint cinq ans plus tard l’un des « mignons » avec le duc Anne de Joyeuse, son rival. À l’origine, le mignon est un statut qui n’a rien à voir avec une attirance sexuelle, mais une reconnaissance du roi envers une personnalité qui l’a servi avec loyauté lors d’une entreprise militaire et politique. Il s’agissait souvent d’une amitié qui n’impliquait pas de liens intimes. Ce sont les Huguenots et les franges protestantes qui ont détourné l’origine du mot pour se moquer et affaiblir l’entourage royal et l’intérêt remarqué du souverain pour les hommes. D’ailleurs, la chronique précise, sous la plume de Jacques Auguste de Thou, historien, écrivain et homme politique, que le roi Henri III aimait éperdument Jean-Louis de Nogaret, un homme séducteur plein de charisme et d’esprit.
Une irrésistible ascension
Principal conseiller d’Henri III, Jean-Louis de Nogaret de la Valette va accumuler un grand nombre de fonctions prestigieuses. Il sera Pair de France, gouverneur de différentes provinces, dont la Guyenne naturellement, amiral de France, premier gentilhomme de la chambre du roi et duc d’Épernon, un duché taillé sur mesure pour lui par le roi Henri III en 1581. Doté d’une autorité naturelle exceptionnelle, brillant, mais singulier, « le verbe vif et la franchise du terroir » comme l’écrit le site Escola Gaston Febus, il a gardé son accent gascon jusqu’au bout et il se moquait bien des tentatives de « dégasconisation » souhaitées par la cour. C’est en 1587 que le duc d’Épernon a épousé Marguerite de Foix-Candale issue d’une famille d’un rang bien plus élevé que le sien, fille du comte de Foix, de Candale, de Benauges et d’Astarac. Elle était par ailleurs héritière du Captalat de Buch, en Gascogne occidentale autour du bassin d’Arcachon. Marguerite lui donnera trois fils.
FIDÈLE À SA FOI CATHOLIQUE SANS L’EXCÈS DES GUISE
Le duc d’Épernon demeura fidèle à sa foi catholique contre le protestantisme grandissant, tout en rejetant néanmoins les excès du duc de Guise et de la Ligue catholique ou de la Sainte Ligue, encore appelé Sainte Union. D’ailleurs, en bon diplomate et alors gouverneur de Guyenne, il servit de trait d’union entre le roi Henri III et le protestant Henri III de Navarre, futur roi Henri IV. Le duc d’Épernon s’efforça de ne pas rajouter une guerre civile du trône aux divisions religieuses dans le royaume. Il exhorta, en vain, Henri de Navarre de revenir au catholicisme et impulsa avec intelligence et subtilité une volonté de fédérer les catholiques et les protestants jugés modérés et responsables, entre 1584 et 1589. Il sera momentanément écarté des affaires dans un souci d’apaisement, et du plus du tiers de la France qu’il contrôlait. Le duc sera momentanément réduit à la fonction de gouverneur de l’Angoumois.
On le déteste ou on l’admire
Le duc d’Épernon ne laisse pas indifférent, on l’admire ou on le déteste. Son opposition à la ligue ne le rend pas populaire auprès du peuple fondamentalement catholique, et on tentera même de l’assassiner. Il fut toujours soutenu par les Castelbajac, les Montesquiou ou encore les Cominges, alors que des ennemis puissants se méfieront de lui, comme Sully ou Richelieu bien plus tard. La chronique précise qu’il n’hésita pas à traiter de « petit coquin » Nicolas de Villeroy, pourtant ministre de Charles IX à Louis XIII. Pour mener à bien sa volonté d’affaiblir la ligue devenue puissante et dangereuse pour le pouvoir royal, il s’est appuyé sur des provinces méridionales qu’il contrôlait, comme la Saintonge ou encore la Provence, ainsi que sur son alliance avec le duc de Montmorency, alors gouverneur du Languedoc. Quant aux ligueurs, ils étaient particulièrement bien installés dans le grand sud du royaume, de la Guyenne au Dauphiné. Lors de la guerre anglo-espagnole, le duc d’Épernon agira pour que l’Invincible Armada de Philippe II d’Espagne ne puisse utiliser en soutien le port de Boulogne.
Assiégé à Angoulême
Lors de la journée des Barricades en 1588, soulèvement des Parisiens impulsé par le duc de Guise et le Conseil des Seize, le duc d’Épernon dut se résoudre à s’éloigner de la cour, momentanément sacrifié par Henri III face aux exigences des ligueurs. Il demeura cependant gouverneur de la Saintonge et de l’Angoumois et se retira à Angoulême. Cependant le maire de la cité reçut un courrier du roi lui interdisant d’accueillir le duc d’Epernon, alors que l’ordre de l’arrêter et de le conduire à Blois fut adressé à Souchet. Lors de la tentative de la prise du château où séjournait le duc, le maire fut tué dans la fusillade et l’assaut repoussé. Une amnistie a alors été signée, mais d’Épernon fut convaincu que cette audacieuse attaque était l’œuvre de son ennemi Villeroy. Le 15 juillet 1588, Henri III avait par obligation signé l’Édit d’union avec la Ligue catholique, instaurant ainsi les bases d’une alliance entre la Ligue et la monarchie, mais le roi rappela le duc d’Épernon aux affaires après la mort du duc de Guise qu’il avait orchestrée. Le favori du roi et son principal conseiller récupérèrent une partie de ses charges de gouverneur de Provence et Amiral du Levant. Assassiné en 1589 par le moine dominicain Jacques Clément, un ligueur qui voulut se venger de la mort du duc de Guise, Henri III au seuil du trépas, demanda au duc d’Épernon de se rallier au protestant Henri de Navarre, appelé à lui succéder. Avec la mort d’Henri III, la branche des Valois disparut de la scène politique au profit des Bourbons dont Henri IV fut le premier représentant sur le trône de France.
RELATONS TENDUES, MAIS SERVITEUR DU ROI HENRI IV
Les relations entre le nouveau roi Henri IV et le duc d’Épernon ont parfois été conflictuelles et même houleuses, mais les deux hommes s’appréciaient et le roi le considérait comme un ami, certes au tempérament vif, mais franc, et un fidèle serviteur. Moins présent auprès du roi quelque temps, le duc mit à profit sa relative disponibilité pour suivre le chantier de son délicieux château de Cadillac dominant la Garonne au sud de Bordeaux, dont les cheminées entièrement recouvertes de marbre sont aujourd’hui considérées comme les plus belles de France. Il se réjouissait de retrouver régulièrement sa Gascogne tout en demeurant influent en obtenant notamment auprès d’Henri IV le retour des jésuites et l’établissement dans les territoires de sa gouvernance de la Compagnie de Jésus fondée par Ignace de Loyala.
Une amitié de longue date
Le règne d’Henri IV fut tout de même une période de contrariétés pour le duc d’Épernon qui s’en accoutuma tout en restant vif dans ses conseils. Les deux hommes se connaissaient de longue date, depuis qu’Henri de Navarre eut été retenu à la cour de France alors que le duc d’Épernon n’était qu’un cadet de Gascogne. Henri IV pouvait parfois reprocher au duc sa réserve, voire son hostilité. D’Épernon répliqua dans sa franchise habituelle « Sire, votre majesté n’a pas de plus fidèle ami que moi, mais pour ce qui est de l’amitié, votre majesté sait bien qu’elle ne s’acquiert que par l’amitié ». Le roi lui écrivait cependant des lettres aimables, mais se méfiait tout de même en le faisant discrètement surveiller. La chronique précise que, même un jour, s’adressant à Louis XIII, il dit « majesté, vous êtes le petit-fils d’un grand roi », allusion à Henri III et snobant ainsi Henri IV.
Le roi assassiné rue de la Ferronnerie
Henri IV fut assassiné le 14 mai 1610 alors que son épouse Catherine de Médicis avait été couronnée la veille, validant ainsi la régence qu’elle exerça jusqu’à la majorité de son fils, le futur Louis XIII, et ouvrant ainsi les portes du pouvoir aux catholiques de ses relations. Le duc d’Épernon avait demandé d’accompagner le roi chez Sully qui était souffrant. Il se trouvait donc dans le carrosse lorsque François Ravaillac porta les coups mortels à Henri IV. En tant que gouverneur de l’Angoumois, le duc avait connu Ravaillac, originaire d’Angoulême, qui avait eu à faire avec les services de police. Avant de commettre son méfait, Ravaillac avait été hébergé chez une amie du duc d’Épernon et de la marquise de Verneuil, dame de compagnie de la reine et maîtresse d’Henri IV. Sully, rival d’Épernon, et les Huguenots saisirent l’occasion pour l’accuser, à tort, d’avoir commandité l’assassinat du roi.
Un procès à rebondissements
Mademoiselle d’Escoman, pourtant dame de compagnie de la duchesse de Verneuil, n’hésita pas à formuler des accusations contre sa maîtresse, en l’accusant d’avoir organisé l’assassinat du roi avec la complicité du duc d’Épernon. Premier président du tribunal, Achille de Harlay mit en détention mademoiselle d’Escoman pour suspicion de mensonges. Harlay, devenu retraité, fut remplacé sur requête de la Régente par Nicolas de Verdun, un proche du duc d’Épernon. Le 30 juillet 1611, d’Escoman fut condamnée pour calomnie à la prison à vie.
AU SERVICE DE LOUIS XIII
À peine deux heures après le trépas d’Henri IV, le duc d’Épernon prit immédiatement des dispositions pour que le parlement transmette les pouvoirs à Marie de Médicis, désormais régente du Royaume, alors qu’Henri IV aurait indiqué plutôt souhaiter un Conseil de régence. Concini, aux affaires désormais, opéra une grande influence sur la Régente. Il parvint tout de même à faire écarter le Gascon de l’entourage de Marie de Médicis. Louis XIII put réellement exercer le pouvoir à partir de 1617 en remerciant les meurtriers de Concini qu’il a commandités « Grand merci à vous, à cette heure, je suis roi ! »
Le retour au pouvoir
Lors du blocus contre les protestants à Saint-Jean-d’Angely en 1621, d’Épernon fut blessé, mais reviendra plus fort en 1622 à l’appel de Louis XIII qui voulut s’entourer de conseillers de qualité et d’hommes forts. À soixante-sept ans, en 1622, le duc d’Épernon jouissait d’une image d’un homme habile, mais fidèle qui avait déjà servi avec brio Henri III et Henri IV et les régences. Il devint gouverneur militaire de Guyenne entre 1622 et 1648 et parvint à réprimer les révoltes huguenotes. Il fut une nouvelle fois en 1622 duc et pair de son fief de Villebois en Charente actuelle, plus haute distinction de la noblesse de France derrière les princes de sang royal. Louis XIII, soucieux de renforcer sa garde personnelle, la dota de mousquets, armes à feu à longs canons. Il demanda au duc de mettre à sa disposition quelques-uns de ses meilleurs éléments, des Gascons du Béarn, pour renforcer cette compagnie de gens à mousquets qui deviendront des mousquetaires. De retour en Gascogne, le duc d’Epernon s’installa au château de Cadillac dans le Bordelais, sur les bords de Garonne. Son fils et héritier Bernard épousa Gabrielle-Angelique de France, fille naturelle du roi Henri IV et de sa maîtresse, la marquise de Verneuil.
La lutte avec Richelieu
Cardinal, pair de France et principal ministre de Louis XIII, Armand Jean du Plessis de Richelieu se méfiait du prestige, de l’autorité et de l’influence du duc d’Épernon, homme capable d’avoir pu servir plusieurs souverains successifs. Deux volontés politiques étaient en contradiction, celle de Richelieu qui orienta sa politique vers la centralisation du royaume et celle d’Épernon qui aspirait plutôt au maintien d’une forme de féodalité au sens du maintien de relatives indépendances des territoires. Le duc ne se gênait pas pour formuler des critiques sur les conséquences locales des choix de Richelieu. Irrité, le cardinal cherchera à amadouer d’Épernon, toujours au caractère indomptable, pour mieux le contrôler, mais en vain. Alors, il lui compliqua sa gouvernance en Guyenne et, dès lors donna systématiquement raison à ses adversaires. Le cardinal le discrédita même lors de nouvelles guerres de religion et encouragea même les différents protagonistes religieux à rendre d’Épernon responsable de l’échec de Fontarabie, une défaite française contre les Espagnols lors d’un épisode de la guerre de Trente Ans.
Le Béarn rattaché au royaume de France
C’est en 1620 que le Béarn perdit son indépendance. Sur ordre de Louis XIII, il fallait anéantir les protestants en brisant les murailles de ces villes huguenotes du sud de la Gascogne en coupant vivres et ravitaillements. Ce fut aussi la mission d’Épernon qui chercha néanmoins une position plus modérée, ce qui irrita fort la cour. Désormais, il n’aura plus la confiance du roi ni des huguenots. Ce fut le début de la fin pour le duc, une chute accélérée par le soufflet à l’archevêque Henri de Sourdis.
L’accrochage avec l’archevêque de Bordeaux
Les relations tendues, voire exécrables avec Henri de Sourdis vont conduire le duc à souffleter, comme l’on disait à cette époque, l’archevêque en 1634 à Bordeaux. Contraint par Louis XIII de corriger l’offense à s’agenouillant devant l’archevêque, d’Épernon fut progressivement écarté du cercle du pouvoir et des affaires. Démis de ses fonctions en 1638, il meurt en disgrâce à 87 ans en 1642 à Loches puis rapatrié, selon ses vœux, en Gascogne occidentale, appelée la Guyenne. Jean-Louis de Nogaret de la Valette, duc d’Épernon, repose dans la collégiale Sainte-Blaise face au château de Cadillac. Jusqu’à la Révolution, une petite cloche sonnait tous les matins à six heures « les pleurs d’Épernon pour le repos de son âme » à la cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême où son cœur est déposé.
Jean-Louis de Nogaret de la Valette, duc d’Épernon, n’a pas la place méritée dans l’histoire de France, où la part belle est surtout faite aux monarques ou aux grands ministres et militaires. Les autres grands personnages, comme les conseillers de premier plan, les plus brillants et les plus audacieux, ont une place plus limitée. Peu connu, il a pourtant servi l’état avec brio, audace et fidélité. La vie de ce gascon, éternellement au service du royaume, est une véritable saga. Il a pratiquement tout réussi, fort d’un immense tempérament et d’une farouche volonté d’inscrire son nom dans la construction du royaume de France.
.
Philippe Estrade Région de France. Pluton-Mag 2025