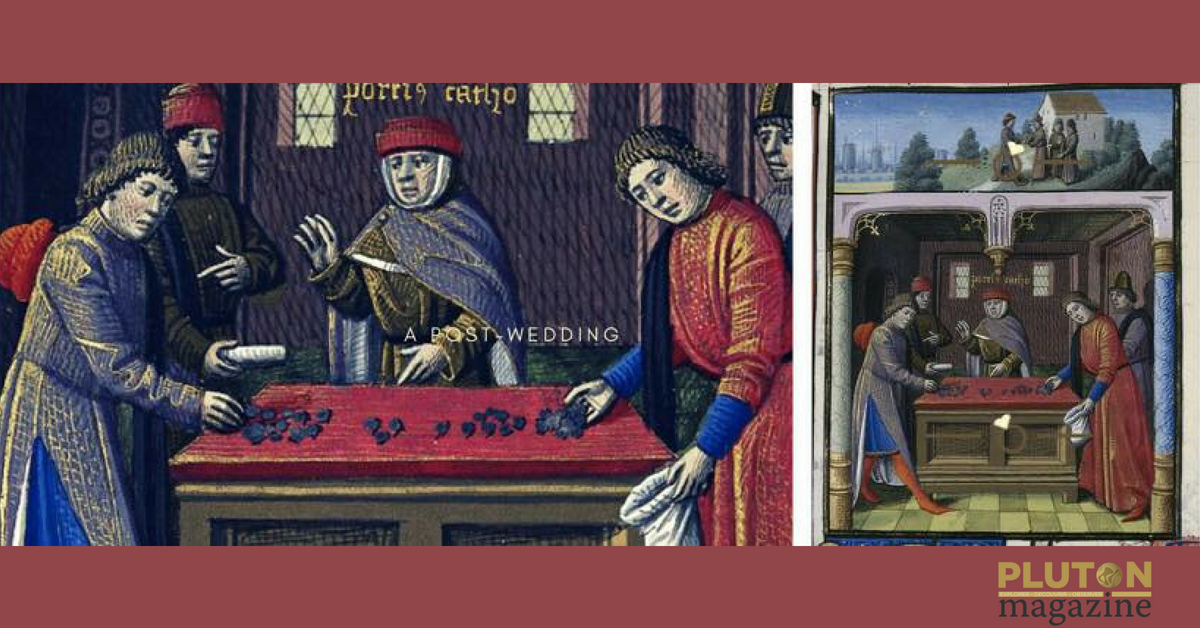Par Fiona McIntosh-Varjabédian
(Fiona McIntosh-Varjabédian (Université de Lille 3)
Professeur de littérature comparée)
Le 26 mars 2018, le Professeur Richard Vedder, spécialiste d’économie, revient dans Forbes[1] sur la disparition du cursus universitaire de treize disciplines majeures, parmi lesquelles l’anglais, l’histoire et la philosophie, à l’université du Wisconsin. Il pointe vers quelques explications à savoir la perte de rentabilité de ces disciplines dans un nouvel horizon universitaire où la rentabilité justifie l’existence ou non d’une discipline et non plus sa contribution intrinsèque au savoir, à la culture et à la formation intellectuelle de l’honnête citoyen.
Lorsque l’éducation est chère et provoque l’endettement de millions d’étudiants, les filières qui semblent ouvrir sur des métiers et surtout vers des métiers bien rémunérés priment sur celles qui peuvent paraître moins immédiatement utiles. Si Richard Vedder tord le cou à l’absence de rentabilité des Humanités et prouve que leurs diplômés peuvent parfaitement occuper un emploi (économiquement) utile dans la société, en raison des compétences que celles-ci développent, il n’explicite guère la nature desdites compétences qui sont ramenées au développement de l’esprit critique, ce qui, ma foi, si on peut me permettre l’expression, est un peu la tarte à la crème que les défenseurs de ces disciplines sortent pour défendre leur domaine de prédilection. En disant cela, je n’implique pas que cela soit faux, mais que c’est sans doute insuffisant d’un point de vue social et médiatique. C’est également de façon très allusive qu’il met en cause certaines évolutions des études culturelles, on pense notamment aux gender studies, aux queer studies et aux post-colonial studies, qui, selon lui, rebuteraient certains esprits conservateurs et contribueraient de ce fait au déclin des disciplines qu’elles touchent, un comble lorsqu’on sait qu’elles ont été créées pour moderniser les disciplines traditionnelles et les inscrire dans de nouveaux combats politiques.
Mon but, ici, n’est pas de discuter si les études culturelles ont permis de sauver les humanités ou si elles les ont effectivement mises en danger, il est de voir comment la crise actuelle à la fois des vocations et de prestige social des humanités est révélatrice d’une crise plus large, celle de l’interprétation. Au milieu de menaces autrement plus graves qui s’affichent tous les jours en tête des journaux, comme cela semble futile et anecdotique. Encore une universitaire qui n’a rien compris à la vie, me direz-vous ? Peut-être, mais peut-être pas, car la relégation de l’interprétatif laisse place soit à une lecture de plus en plus littérale des discours et de l’écrit, soit à une instrumentalisation des textes et des images qui se plient à l’interprétation que le lecteur, voire un régime veulent leur donner. Elle aboutit in fine à un rejet grandissant de la complexité, de l’entredeux et parallèlement à des positions de plus en plus exclusives – car on est soit ceci soit cela— qui menacent la diversité créative et modératrice des points de vue et qui nous rendent moins aptes à affronter des situations sociales et politiques de plus en plus difficiles à appréhender. Comme le rappellent Maud Champagne-Lavau, Laura Monetta, et Noémie Moreau d’un point de vue clinique cette fois, la capacité de saisir des messages de façon non littérale contribue au bon fonctionnement du groupe communautaire et au bien-être de l’individu dans la société[2]. Le fait que cette affirmation vienne de cercles médicaux témoigne des enjeux potentiels de cette question.
On ne saurait réduire, en effet, le discours et les textes à leur fonction purement utilitaire, de vecteur transparent d’un message. La dévalorisation de l’acte interprétatif vient du fait qu’on n’en ressent plus l’utilité : on partage une langue, on est donc apte à comprendre et à communiquer sans qu’il y ait besoin de décoder ce qui est écrit ou prononcé dans cette langue commune. C’est un a priori de plus en plus ancré. Toutefois, pour être un bon lecteur ou auditeur, il faut être capable de comprendre entre les lignes ce que le texte ou l’interlocuteur ne semblent pas dire mais qu’ils disent néanmoins, ce qui implique de déceler l’ironie, le sarcasme, les métaphores et les figures de style, mais également un grand nombre de présupposés liés au contexte, comme le montre François Recanati[3]. La liste pourrait être encore longue, elle va de pratiques assez courantes : je pense à l’emploi d’expressions toutes faites qui, mot à mot, dans une traduction, ne voudraient rien dire et qui ont l’art de déconcerter les étrangers, ou les petits enfants. Un froid de canard ? le palmipède serait-il particulièrement froid ? It rains cats and dogs : personne n’a jamais vu des chats et des chiens tomber avec la pluie ! Faire avaler des couleuvres : on imagine l’expression de ceux qui n’y verraient pas une expression figurée. La liste des situations où il faut être capable d’aller au-delà de ce qui est dit littéralement concerne aussi des stratégies plus retorses comme quand un personnage dans un livre prend la parole pour exposer des idées ou des thèses qui ne sont pas communément acceptées : est-il censé représenter ce que l’auteur considère comme vrai ou, au contraire, l’auteur s’en sert-il pour caricaturer ce qu’il pense être faux et scandaleux ? L’ironie des philosophes des lumières a souvent usé de ce subterfuge, notamment pour échapper à la censure, non que les censeurs fussent bêtes et ne comprissent pas l’ironie, mais l’auteur, si nécessaire, pouvait toujours se désolidariser en quelque sorte du personnage et feindre une condamnation. Par l’entre-deux, il échappait au flagrant-délit.
D’ailleurs, le message réduit à une univocité ultime n’est pas, comme nos communicants le fantasment, un garant d’efficacité absolue. Le langage, dépourvu de ses subtilités et de ses attributs ludiques ou pittoresques, éviterait peut-être des disputes sans fin sur les réseaux sociaux pour une ironie mal comprise, mais, comme l’exprime François Ost, dans un texte inspiré de l’histoire de Babel : « Leur discours était devenu si univoque qu’il n’était plus qu’un interminable soliloque : auraient-ils voulu échapper à cette prison qu’ils n’eussent même plus disposé de mots pour articuler cette pensée. »[4] Le littéralisme étriqué qui emprisonne la pensée ne touche pas seulement au langage : songeons au personnage de Charles Dickens dans Temps difficiles, Gradgrind, qui ne veut que des faits, rien que des faits et s’insurge qu’on puisse représenter des chevaux sur des papiers peints parce qu’une telle image littéralement n’a pas de sens. Toute forme de représentation ne doit dire ou montrer que ce qui est et ne correspond qu’à une visée strictement utilitaire, tel est le credo de Gradgrind qui veut l’imposer aux enfants à sa charge. Dickens appelle cela « le massacre des innocents », je partagerais volontiers cette idée.
Si le fait de prendre au pied de la lettre représente clairement une mauvaise lecture, à l’inverse, la réduction de la lecture et de la compréhension au « ressenti », à ce que le lecteur ou l’interlocuteur perçoit et reçoit en raison de son expérience personnelle est également délétère. Si toutes les formes de compréhension se valent et ne doivent pas être hiérarchisées parce que l’expérience personnelle du récepteur prime, le discours de l’autre se trouve réduit à ce qu’il provoque. Reprenons le cas de l’ironie : est-il légitime que je sois éventuellement offensée si je ne la perçois pas et que je considère à tort qu’il s’agit d’une affirmation pleine et entière ? Imaginons qu’on veuille interdire une œuvre qu’on juge offensante parce qu’on n’a pas pris en compte un certain nombre d’indices convergents qui montrent que l’intention de l’auteur n’était pas d’offenser. Qu’est-ce qui prime ? La conception du créateur ou le sentiment, éventuellement erroné, de celui qui l’a reçu ?
Dans un rapport policé et courtois, la vérité est un peu entre les deux. D’un côté, on cherche à anticiper sur ce qui peut blesser, de l’autre, on essaye d’écouter ce qui est dit et de prendre la mesure des gages de bonne volonté que le locuteur nous donne. Le bon mode de compréhension fait qu’on est à la fois capable de comprendre le non-dit et de ne pas faire dire aux autres tout ce que l’on veut. Cette communication policée est le résultat d’un apprentissage qui, selon les circonstances et les usages, est plus ou moins sophistiqué. Plus le contexte est immédiatement présent, plus ce travail se fait automatiquement, sans qu’on y réfléchisse. François Recanati a donné un certain nombre d’exemples de désambiguïsation dans des situations de dialogues quotidiens. En présence d’un interlocuteur, le ton, la gestuelle sont là pour donner des indications supplémentaires sur l’intention de celui qui parle, à moins bien sûr d’être en face d’un menteur ou de quelqu’un qui cherche à tromper. Lorsque le contexte immédiat n’est pas là, que ce soit sur les réseaux sociaux ou face à un texte qui a perdu son actualité première, ou qui a vocation à être lu détaché des circonstances d’émission, la tâche est beaucoup plus compliquée.
Ces débats ne sont pas neufs. Ils ne sont pas confinés non plus dans le seul espace de la classe. Droit, religion, mathématiques, logique ont été touchés et s’en sont emparés : la question est de savoir, dans le premier cas si c’est ce qui est dit ou écrit mot pour mot qui prime sur le contexte et sur l’intentionnalité perceptible[5] de celui qui écrit ou prononce un message ; dans le second, si la réception potentielle du message prime sur ce qu’on pourrait considérer comme une compréhension commune.
Prenons d’abord le cas de la lecture littérale. Le droit est peut-être un des domaines où la distinction est la plus évidente entre la lettre de la loi et son esprit, entre, en somme, la généralité d’un discours tel qu’il avait été envisagé par le législateur et les conditions de son application particulière, qui peuvent être précisées progressivement par la jurisprudence. Les amendements de la loi doivent de façon idéale être en cohérence avec la loi initiale, avec les autres amendements qui sont promulgués et avec l’esprit même du système juridique dans lequel il s’inscrit[6], ce qui est source d’interprétation. Il s’agit d’une cohérence qui se dessine dans le temps et qui, selon David Luban, permet d’instaurer une norme qui, certes, évolue en fonction des circonstances mais dans le cadre imposé de l’esprit de la loi. Cela peut être assurément source de désaccords et de controverses, ne serait-ce que dans la définition des termes de la loi. Mais faut-il vraiment le regretter ?
Dans le rêve d’une langue parfaite qu’on trouve périodiquement dans l’histoire, les philosophes, et notamment certains philosophes du droit[7] ainsi que les mathématiciens ont manifesté le désir de parvenir à un langage qui réduirait « les redondances, les anomalies, les équivoques et les ambiguïtés », pour améliorer la communication entre les peuples et éviter précisément les discussions sans fin sur le sens des mots ainsi que les conflits dus à l’impossibilité de trouver un accord entre les parties en présence[8]. La langue parfaite serait celle qui nécessiterait le moins une interprétation subjective. Umberto Eco attribue cette préoccupation de créer une langue formelle, qu’il trouve très britannique en raison de sa récurrence sous les plumes de George Dalgorno, de John Locke ou de David Hume, aux problèmes que les savants outre-Manche pouvaient avoir avec le latin ! Le souci est plus probablement religieux dans la très presbytérienne Écosse, pays de naissance justement de Dalgorno, Locke et Hume ; car comme le rappelle Thomas H. Luxon, le protestantisme s’est affirmé dans la volonté de revenir à la lettre du texte biblique contre les équivocations pratiquées par les clercs et parmi les Protestants, les Calvinistes – dont font partie les Presbytériens et les Puritains – sont les plus attachés à la lecture littérale[9].
En effet, le désir de revenir aux sources de la Loi et de la Bible les avaient conduits à rejeter les commentaires et notamment les quatre sens, (littéral, allégorique, tropologique, et anagogique dans la tradition chrétienne) qui étaient attribués au texte biblique, pour ne privilégier que le premier inscrit dans la lettre. La sophistication de l’interprétation seconde vient s’opposer, selon eux, à la simplicité du message initial qui, pour le croyant réformé, devait permettre la rencontre directe du divin et du lecteur fervent. L’opposition entre les Catholiques et les Protestants, on la connaît : outre des points théologiques qui ne sont pas du ressort de cet article, le problème est bel et bien une question de lecture. D’un côté, ceux qui réservaient la Bible à une lecture savante qui devait être sanctionnée dans le cadre d’une tradition ; de l’autre, ceux qui considéraient que cette tradition constituait un obstacle à la rencontre du croyant avec le Verbe qui s’exprime, selon eux, au travers de la Bible. Au fond, pour revenir au terme du débat initial, c’était en quelque sorte l’intentionnalité divine qu’il s’agissait de retrouver intacte et qui avait été obscurcie par le clergé qui se l’était appropriée de façon illégitime. Le retour à la source du Livre est-il possible quand plus d’un millier d’années se sont déroulées ? Comme on la vu brièvement pour les lois civiles, la compréhension de la lettre elle-même est tributaire du temps, même si dans le cadre des lectures les plus littéralistes, les textes divins se donnent à lire une fois pour toutes. À l’inverse de cette décontextualisation totale, faut-il chercher à adapter systématiquement le message au temps présent, à le rendre cohérent avec les circonstances contemporaines ? Ces débats qui mettent en jeu deux modes d’interprétation et de compréhension n’ont pas seulement eu une résonnance au XVIe siècle, au sein du seul Christianisme : mutatis mutandis, notre XXIe siècle n’en est pas exempt, les journaux sont là pour en porter le témoignage, parfois de façon tragique.
C’est pourquoi il importe de ressaisir toute l’importance de l’acte d’interprétation et d’en acquérir les compétences. On peut donner certaines règles pour y parvenir : comprendre qu’un texte est issu d’un contexte et d’une époque, cela ne veut pas seulement prendre en compte les valeurs relatives au temps, au lieu, aux mœurs, les références culturelles spécifiques mais également les variations de vocabulaire et de grammaire pour éviter les contresens. Il convient également de prendre le texte de façon globale, comme un système où l’information et le sens se précisent par leur insertion dans un ensemble plus grand. Je pense notamment à un passage d’un roman de Smollett, L’Expédition de Humphry Clinker, que j’ai étudié récemment avec mes étudiants. C’est un roman épistolaire que l’auteur écossais avait écrit peu avant sa mort en 1771. Dans une lettre de son personnage fétiche Matthew Bramble, célibataire hypocondriaque, il critique fortement un mari faible qui se laisse mener par la folle vanité de sa femme, jusqu’à ce qu’il soit mené à la ruine et que sa propriété prospère tombe en faillite. Bramble suggère que son ami devrait reprendre les rênes. Un cas typique de misogynie du XVIIIe siècle, me direz-vous ? Si l’on en reste là, oui, indubitablement. Mais si on comprend que cette lettre a son parallèle et que cette fois, le même Bramble loue la réussite d’un couple équilibré, où la femme, cette fois très sensée et raisonnable, à égalité avec son mari, contribue à la prospérité de leur domaine, la conclusion est autre. L’ordre des deux signifie que c’est la deuxième expérience qui l’emporte sur la première et le défenseur du pouvoir patriarcal se transforme en défenseur de l’égalité. Le ressenti, la réaction spontanée du lectorat contemporain ont tendance à faire sortir tel au tel passage d’une globalité. C’est en cela qu’il doit être nuancé, voire corrigé par un point de vue plus global, ce qui est impossible si l’on suit à la lettre les dix commandements du lecteur selon Daniel Pennac. Je pense notamment au deuxième, à savoir « Le droit de sauter des pages » et au troisième « Le droit de ne pas finir un livre ». S’il est légitime, comme Pennac, de privilégier le plaisir de la lecture, les goûts du lecteur et ses réponses immédiates, viscérales, il faut un lieu et un moment où ce but ne saurait être le seul. Lire, c’est aussi vouloir comprendre, car sans cette compréhension, on ne découvre pas l’autre. Il faut un lieu où on se plie à l’exercice de la lecture savante, et où on s’arme de tous les instruments de la philologie, de la rhétorique et de la mise en contexte historique. En somme, il convient de trouver un équilibre entre une naïveté éventuellement erronée et une glose qui s’autoalimenterait et qui aboutirait à une instrumentalisation des textes à des fins idéologiques.
Rédactrice Fiona McIntosh-Varjabédian
Secrétaire de rédaction : Colette FOURNIER
Pluton-Magazine/2018
Photo: Justice from BL Harley 4375, f. 135v | Valerius Maximus, translated by Simon de Hesdin and Nicholas de Gonesse.
The British Library, the european Library. United Kingdom.
Notes:
[1] https://www.forbes.com/sites/richardvedder/2018/03/26/the-end-of-history-and-more/#180397101515
[2] Maud Champagne-Lavau, Laura Monetta, Noémie Moreau, « Impact of educational level on metaphor processing in older adults », Revue française de linguistique appliquée, 2012/2 (Vol. XVII), p. 89-100. URL : https://www-cairn-info.proxy.scd.univ-lille3.fr/revue-francaise-de-linguistique-appliquee-2012-2-page-89.htm
[3] François Recanati, Literal Meaning, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, p. 13 sq.
[4] François Ost, Traduire. Défense et illustration du multilinguisme, Paris, Fayard, 2009, p. 9.
[5] Jocelyn Benoist, « Les métaphores sont des expressions comme les autres », Archives de Philosophie, 70, 4, 2007, p. 565.
[6] David Luban, « Time-mindedness and Jurisprudence », Virginia Law Review, 101, 4, p. 911 http://www.jstor.org/stable/24363236, consulté le 19 mai 2018 à 16:20.
[7] Id., p. 904.
[8] Umberto Eco, La Recherche de la langue parfaite, Paris, Editions du Seuil, 1994, p. 243.
[9] Thomas H. Luxon, Literal Figures, Puritan Allegory and the Reformation Crisis in Representation, Chicago et Londres, The University of Chicago Press, 1995.