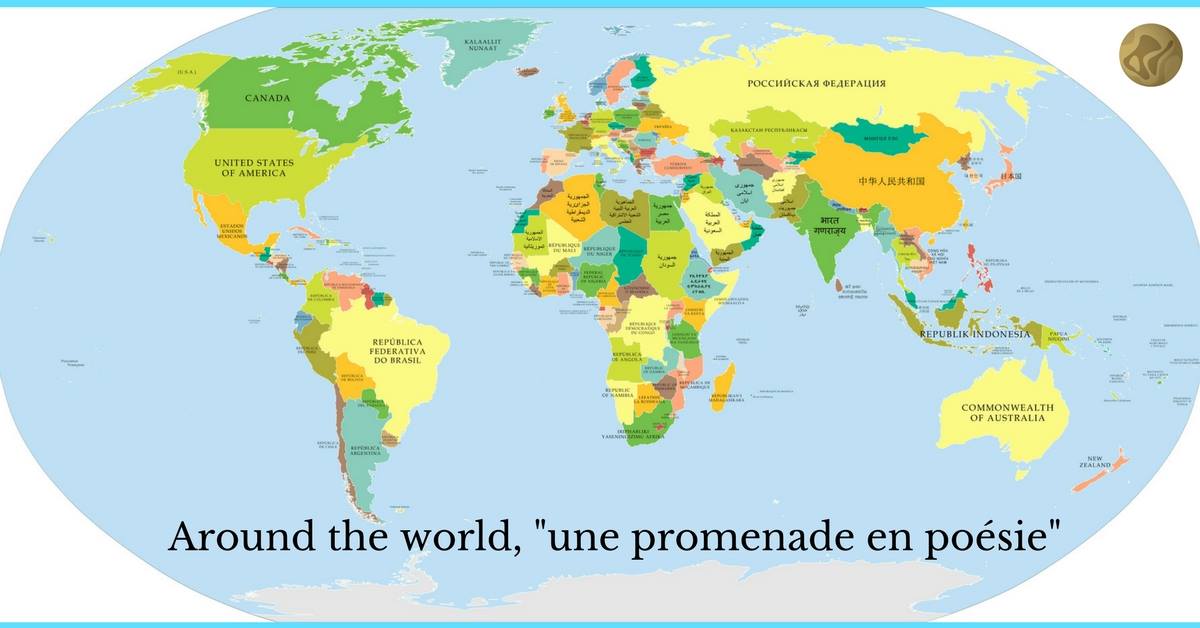Guy TIROLIEN- Aimé CESAIRE-Edouard GLISSANT.
Musique AKIYO.
.
Prière d’un petit enfant nègre
Guy Tirolien
(13 février 1917- 3 août 1988)

Seigneur, je suis très fatigué.
Je suis né fatigué.
Et j’ai beaucoup marché depuis le chant du coq
Et le morne est bien haut qui mène à leur école.
.
Seigneur, je ne veux plus aller à leur école,
Faites, je vous en prie, que je n’y aille plus.
.
Je veux suivre mon père dans les ravines fraîches
Quand la nuit flotte encore dans le mystère des bois
Où glissent les esprits que l’aube vient chasser.
Je veux aller pieds nus par les rouges sentiers
Que cuisent les flammes de midi,
Je veux dormir ma sieste au pied des lourds manguiers,
Je veux me réveiller
Lorsque là-bas mugit la sirène des blancs
Et que l’Usine
Sur l’océan des cannes
Comme un bateau ancré
Vomit dans la campagne son équipage nègre…
.
Seigneur, je ne veux plus aller à leur école,
Faites, je vous en prie, que je n’y aille plus.
.
Ils racontent qu’il faut qu’un petit nègre y aille
Pour qu’il devienne pareil
Aux messieurs de la ville
Aux messieurs comme il faut.
Mais moi, je ne veux pas
Devenir, comme ils disent,
Un monsieur de la ville,
Un monsieur comme il faut.
.
Je préfère flâner le long des sucreries
Où sont les sacs repus
Que gonfle un sucre brun autant que ma peau brune.
Je préfère, vers l’heure où la lune amoureuse
Parle bas à l’oreille des cocotiers penchés,
Ecouter ce que dit dans la nuit
La voix cassée d’un vieux qui raconte en fumant
Les histoires de Zamba et de compère Lapin,
Et bien d’autres choses encore
Qui ne sont pas dans les livres.
.
Les nègres, vous le savez, n’ont que trop travaillé.
Pourquoi faut-il de plus apprendre dans des livres
Qui nous parlent de choses qui ne sont point d’ici ?
.
Et puis elle est vraiment trop triste leur école,
Triste comme
Ces messieurs de la ville,
Ces messieurs comme il faut
Qui ne savent plus danser le soir au clair de lune
Qui ne savent plus marcher sur la chair de leurs pieds
Qui ne savent plus conter les contes aux veillées.
.
Seigneur, je ne veux plus aller à leur école !
Aimé CESAIRE
(26 juin 1913 – 17 avril 2008)

.
Le cadavre d’une frénésie.
le souvenir d’une route qui monte très fort dans l’ombrage des bambous le vesou qui s’invente toujours neuf et l’odeur des mombins
on a laissé en bas les petites jupes de la mer les saisons de l’enfance le parasol de coccolobes
je me tourne au virage je regarde par-dessus l’épaule
de mon passé c’est plein du bruit magique toujours sur le
coup
incompréhensible et angoissant du fruit de l’arbre à pain
qui tombe et jusqu’au ravin où nul ne le retrouve
roule
la catastrophe s’est fait un trône trop haut perché du délire de la ville détruite c’est ma vie incendiée
Douleur perdras-tu
l’habitude qu’on hurle
j’ai rêvé face tordue
bouche amère j’ai rêvé de tous les vices
de mon sang et les fantômes rôdèrent
à chacun de mes gestes à l’échancrure du sort
il n’importe c’est faiblesse
veille mon cœur
prisonnier qui seul inexplicablement survit dans sa cellule
à l’évidence du sort
féroce taciturne
tout au fond lampe allumée de sa blessure horrible
(Aimé Césaire)
AUX ILES DE TOUT VENT
des terres qui sautent très haut
pas assez cependant pour que leurs pieds ne restent pris au pécule de la mer mugissant son assaut de faces irrémédiables
faim de l’homme entendu des moustiques et soif car ce sont pains allongés pour un festin d’oiseaux sable à contre-espoir sauvé ou des bras recourbés pour recueillir au sein
tout ce qui s’allonge de chaleur hors saison
O justice midi de la raison trop lente il n’importe que sans nom à la torche résineuse des langues elles ne sachent que leur offrande terreuse en ce chant de trop loin
téméraire s’accomplit
le matin dans l’insu de ma voix dévoilera l’oiseau que tout pourtant elle porte et
Midi pourquoi elle resta incrustée du sang de ma gorge haletante
des îles de toutes tu diras que selon le cœur comparse d’oiseaux vertigineux
longtemps longtemps cherchant entre les draps du sable
la blessure au carrefour convoité de la mer affouillante
tu trouvas à travers le hoquet
le noyau de l’insulte inclus en l’acre sang
qu’exultant enfin de l’aumaiïle blessée des étoiles
surchauffée à nos souffles fiévreux et conteste
d’un sanglot plus riche que les barres nous sûmes
criant terre cramponnés au plus glissant de la paroi
de l’être
toujours bien disant comme l’on meurt
la noire tête charnelle et crépue du soleil
(Aimé Césaire)
BLUES DE PLUIE
Aguacero
beau musicien
au pied d’un arbre dévêtu
parmi les harmonies perdues
près de nos mémoires défaites
parmi nos mains de défaite
et des peuples de force étrange
nous laissions pendre nos yeux
et natale
dénouant la longe d’une douleur
nous pleurions.
(Aimé Césaire)
Edouard GlISSANT
(21 septembre 1928-3 février 2011)
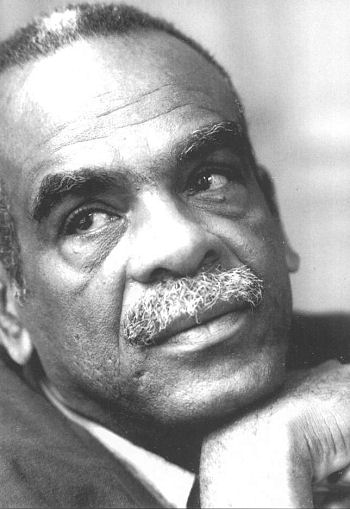
Dans le ventre rouge et noir
.
Dans le ventre rouge et noir où il fallut donc entrer,
Avec sa tête, avec ses pieds,
.
Dans le ventre pareil au vieux morceau de viande
Que le vautour secoue, comme s’il devait,
.
Il n’y a pas de silence où trouver pardon
Et la paroi jamais
N’accueillera de tête fatiguée.
.
Ce n’est pas ici
.
Qu’on pourra tenir de la paix entre ses mains
Comme la terre à fleur d’un pot tombé,
Pendant qu’on apprend à vieillir d’une joie.
.
Ici s’amenuise du peuple fourbu
Tenu à merci dans le ventre froid
.
Et rien ne va
.
Que vers mourir et vers le froid.
.
A moins que ce peuple un jour s’y refuse,
Aussi désirant que du feu de bois,
.
Et troue la paroi vers dehors,
Pour vivre.
.
(Edouard Glissant)
Falaise secrètes
Pensa-t-il aux livres enfouis
Dans ces pays sans spectacles
Où les femmes n’ont plus de mains ?
A ces fulgurances de roches
Que l’on voit aux rivages nus
Guettant quelles vagues encore ?
La mer l’avait envahi
D’un bord à l’autre de son amour.
Le mal que fait l’oiseau blessé
Au nuage qui l’achève,
Mais aussi la glace blanche
De tant de fièvres défrichées,
La plage qui troue la plage.
Il vous fait
Dame de ce lieu
Ombelle nue que le vent porte,
Mue de brasiers beauté la nôtre.
Puis, si belle, la mer l’emporte.
Je vous vois déserte peuplée
Mais toujours étendue de mers
Parce que vous êtes opale
L’hiver avait cette épaisseur
Des mains qui germent dans l’obscur
L’été, pays tôt foudroyé.
Entre ses mains il le maintient
Comme une étrange chevelure
Et c’est pitié que d’y coucher.
Là, sur l’argile des pierres
Le souvenir a déposé
Comme un naufrage roux d’œillets,
Comme d’amours un ossuaire.
Mais où les champs qui se déprennent ?
Où vont les champs quand l’hiver point ?
Tant de mers nous ont traversés.
En moi vous êtes montagne
Pays ô visage impur
D’un pur visage fracassé.
L’orage bâtit ces murailles
La mer que tu hantes brûle
Je ne vois d’oiseaux qu’apeurés.
Croyez-vous que l’orage mente ?
Ces murailles nous ont traqués.
Tel y a mûri ses aubaines
La rivière était froide et pure
Amour d’été est feu d’enfant.
Etoile, c’est la fontaine
Où tu meurs au jour avenant !
Foi d’arbre ne meurt ni ne dure.
Lors étiez-vous labour déchu
De ravages de chevaux fous Étiez-vous plaine qui mesure
A la montagne la pâture
Dont elle fait, hurlants, ses loups ?
Laissez le mal aux naufragés
Vent de sable est vent de torture,
Notre joie naquit tout après.
Labour, ô pays, pur visage
D’un visage impur et blessé.
Le vent dans l’oiseau fait liesse
L’orage vous a délaissée
Ici commence la cassure.
Et cueillez à l’orgue l’orage
En vous il mue et n’a de cesse
Que ne soit plus nuit ce murmure.
(Edouard GLISSANT)
Le taureau
Malgré l’enclos, les écuries,
Malgré l’eau froide à l’abreuvoir,
Le taureau ne peut pas qu’il n’ait rencontré l’homme
Et qu’il n’ait exploré son corps déshabillé,
Sanglant sous la peau blanche.
—
Non pour fermer l’espace où la folie lui vient,
Ni pour goûter une autre chair, d’autres muqueuses,
Mais, comme il signifie,
Pour une raison de dette, inscrite au noir des chairs.
(Edouard Glissant)
LES CHEVAUX
C’est le sang taciturne
Qui fait forts les chevaux.
Ils ont des croupes et des poitrails
De lieux plus sains.
On dirait que les routes,
Que même les rues des villes
Estiment leur pas.
Et c’est dans le respect
Qu’en est transmis le bruit
Jusqu’aux étages où sont les hommes
Qui n’ont que faire.
Cette pomme sur la table,
Laisse-la jusqu’à ce soir.
Va! les morts n’y mordront pas
Qui ne mangent pas le pain,
Qui ne lèchent pas le lait.
C’est étrange pourtant que ce soit la pluie
Dans les tomates gonflées de rouge et de bien-être
Et dans la boue des villes
Qu’on sent partout sur soi.
C’est ainsi qu’on ferme quand c’est l’heure
Et qu’il arrive de faire nuit.
Et qu’on se lève plus tard pour entendre
L’horloge sonner de tout près.
C’est bien la nuit et beaucoup dorment,
Leur soif écrasée.
Si la porte s’ouvrait
Sur ton corps avili
De mort.
Debout encore et nu
Contre l’armoire.
Pâte à ne plus pétrir
De joie.
La maison d’en face
Et son mur de briques,
La maison de briques
Et son ventre froid.
La maison de briques
Où le rouge a froid.
C’est peut-être au-dessus du gouffre du plus rien
Et du noir attendu à l’entrée des forêts,
Peut-être aussi devant des choses plus amères :
La délivrance ou la torture avant demain,
Cette manie encore aux doigts roses et nourris,
Désireux tous les jours des caresses et du jeu,
De plier, déplier, comme ils feraient du temps,
Un fil de fer trouvé, long pas plus que la pipe,
Qui prend presque des formes
Où pouvoir s’agripper :
Dos d’un cheval, profil de chaise ou de bouteille,
Ou bien la lande
Tombant à pic sur un espace
Où pas un œil ne voudra voir.
(Edouard Glissant)